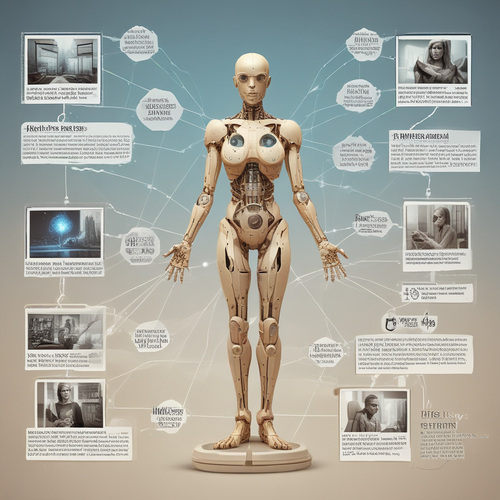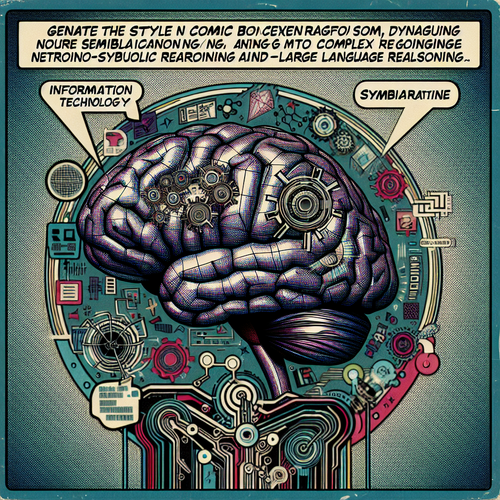Normes juridiques et responsabilité dans l’utilisation de l’IA
Cet essai analyse les défis juridiques posés par l’intelligence artificielle, qui n’a pas d’intentions comme les humains. Les auteurs proposent d’utiliser deux stratégies du droit pour réguler l’IA : l’attribution d’intentions aux programmes d’IA et l’application de normes de comportement objectives, indépendamment des intentions réelles. Cette approche permettrait de tenir les concepteurs et utilisateurs d’IA responsables des préjudices causés, sans se focaliser sur l’absence d’intentions des agents d’IA eux-mêmes.
Points clés
- De nombreux domaines du droit, comme la liberté d’expression ou le droit pénal, dépendent de l’intention de l’acteur qui cause un préjudice
- Les agents d’IA n’ont pas d’intentions comme les humains, ce qui pourrait les immuniser contre toute responsabilité
- Le droit peut attribuer des intentions aux programmes d’IA ou tenir les acteurs humains à des normes de comportement objectives
- Cette approche permettrait de réguler l’utilisation de l’IA sans se focaliser sur l’absence d’intentions des agents d’IA
- Les auteurs appliquent ce cadre à des cas de diffamation et de violation du droit d’auteur par des modèles de langage
- La responsabilité devrait se concentrer sur les concepteurs et utilisateurs humains de l’IA, et non sur l’IA elle-même
À retenir
En somme, la régulation de l’IA nécessite de s’éloigner de la notion d’intention et de se concentrer sur la responsabilité des acteurs humains impliqués. Grâce à l’attribution d’intentions aux programmes d’IA et à l’application de normes objectives de comportement, le droit pourra s’adapter efficacement aux défis posés par cette technologie en pleine expansion. Reste à voir si les législateurs auront le courage politique de mettre en place ce cadre juridique novateur !
Sources
Quiz sur le document: 10 questions